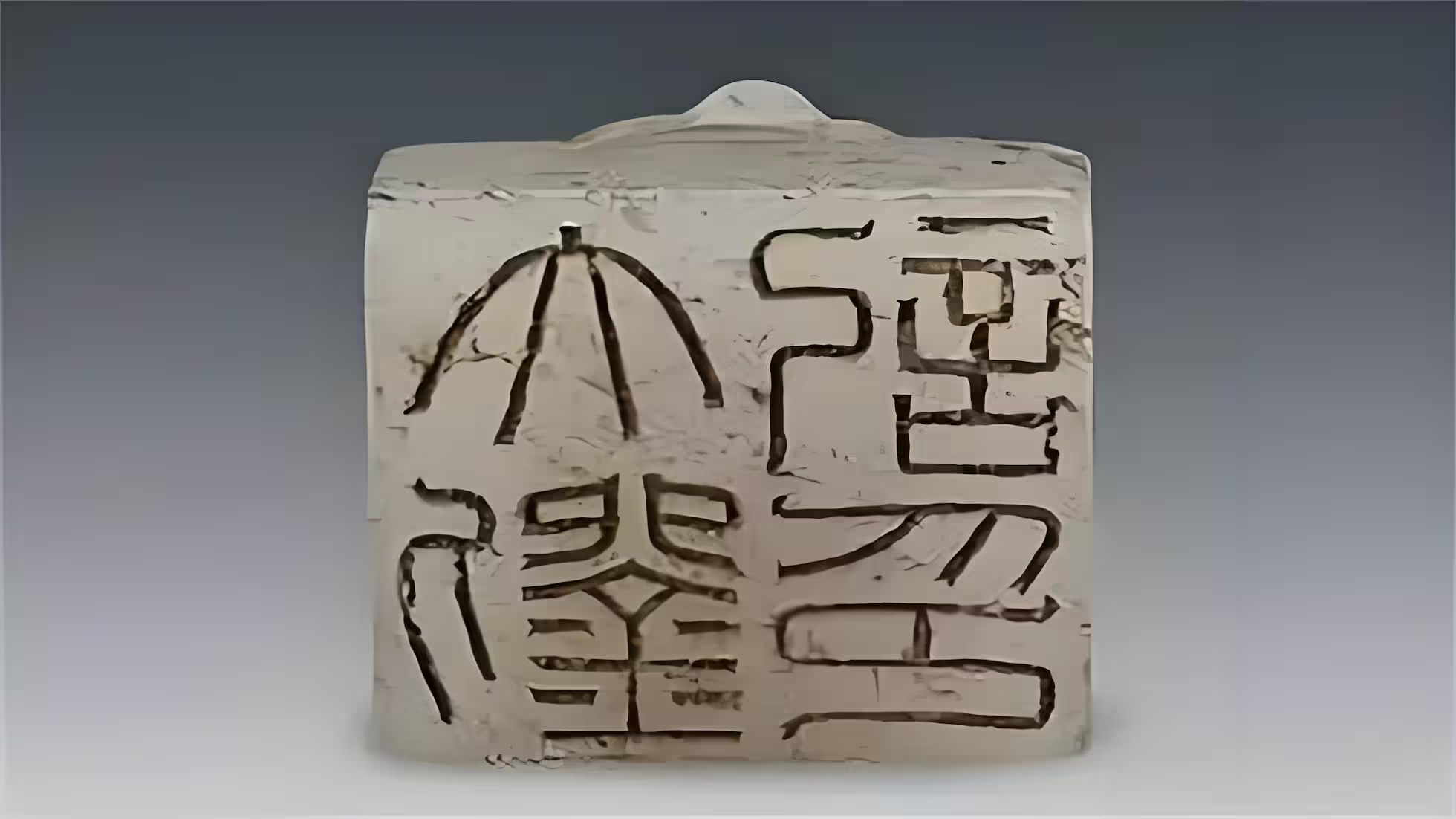Merci d’avoir veillé sur ma richesse
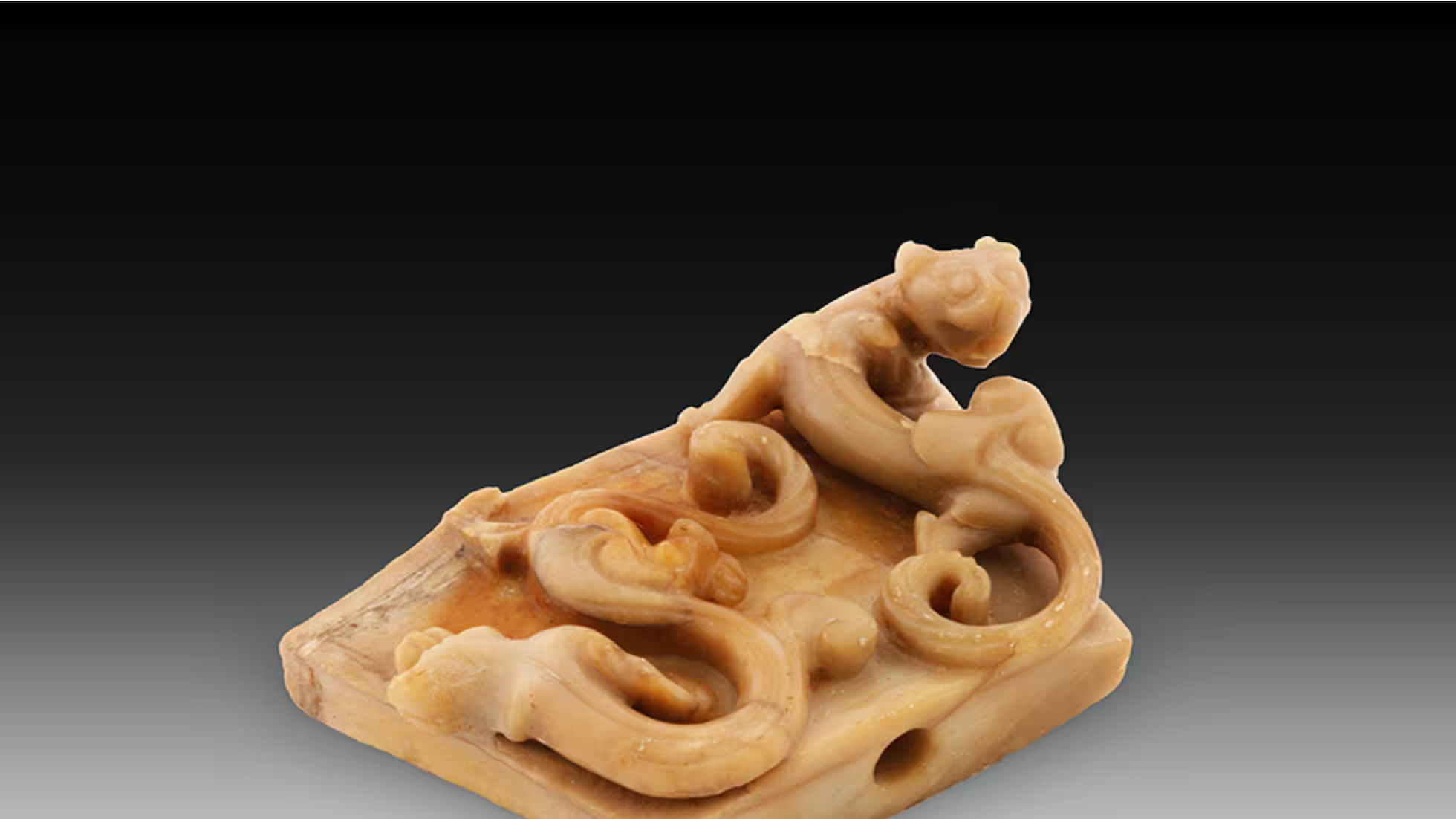
Pendant plus de deux millénaires, la tombe de Liu He fut convoitée par des pilleurs, mais elle s’est en grande partie conservée — un petit miracle, peut‑être une bienveillance particulière envers Liu He et Nanchang (Jiangxi). Quatre facteurs expliquent la préservation des immenses richesses du marquis de Haihun :
Premièrement, « la faveur du ciel ». La fouille de sauvetage fut déclenchée après une tentative de pillage en 2011. Les pilleurs ouvrirent un boyau d’environ 1,5 m de long, 0,8 m de large, et 18 m de profondeur, traversant le tertre, la chambre externe, et jusqu’aux épaisses planches inférieures de la chambre interne. Ils visèrent un point légèrement à gauche du centre (vers l’ouest), pensant que le cercueil se trouvait sur l’axe central. Or, parce que Liu He mourut en charge comme marquis de Haihun, la tombe reproduisait un plan « domestique » : chambre à l’est, salle à l’ouest, espace central dégagé. À cause d’anciens effondrements, la chambre était comblée de vase ; les pilleurs forèrent dans le vide central, ne trouvèrent rien et, pressés par le jour naissant, abandonnèrent sans pouvoir curer l’intérieur. Les autorités culturelles et la police intervinrent aussitôt, évitant un désastre presque certain. Les archéologues découvrirent ensuite que le cercueil se situait au nord‑est de la « chambre » orientale, tandis que les lingots en forme de fer à cheval et les galettes d’or étaient à l’ouest. Un décalage de 2 m à l’est aurait percé le cercueil ; 60 cm à l’ouest, les coffres d’or sous les planches du lit. L’erreur d’alignement sauva la tombe. Plus de dix anciens puits de pillage furent également repérés dans le tertre. L’isolement du site à Haihun (commanderie de Yuzhang), la continuité du marquisat durant 168 ans sur quatre générations — avec une garde du cimetière tant que le fief existait — et la relative paix du Sud lui permirent d’échapper même aux « officiers touche‑or » de Cao Cao.
Deuxièmement, « la terre a aidé ». La chambre en bois, d’une facture raffinée, d’un plan complexe et solidement construite — sommet des palais souterrains en bois de l’époque —, se prêtait mal au pillage avec les moyens anciens. Une grande secousse sismique frappa la région du lac Poyang en 318 (Jin oriental), endommageant la tombe et la comblant de boue et d’eau ; la chambre s’en trouva bourrée, rendant l’évidement fastidieux — mais la richesse fut, de ce fait, protégée. La colline funéraire de Guodunshan devint au fil des siècles un cimetière villageois : tumulus sur tumulus, dissimulant l’emplacement précis et dissuadant les pilleurs.
Troisièmement, « l’eau a protégé ». Le lac Poyang a joué le rôle de gardien. Le rivage de l’ancien marais de Pengli (le Poyang actuel) évoluait ; la ville de Haihun fut longtemps submergée lors d’avancées du lac — « Haihun s’enfonça, Wucheng s’éleva », dit‑on encore. Les fluctuations saisonnières du lac faisaient monter et descendre la nappe phréatique : à l’étiage haut, la chambre était noyée ; plus bas, elle émergeait en partie. Sans techniques subaquatiques, les pillards d’antan s’arrêtaient dès l’apparition de l’eau. Pendant deux millénaires, on n’a laissé que des trous dans le tertre, sans jamais atteindre la chambre — la richesse a subsisté.
Quatrièmement, « l’effort humain ». Les villageois ont protégé le tumulus. En 2011, sans un signalement à temps, un jour de plus aurait suffi pour vider la tombe. Grâce à leur vigilance, nous pouvons aujourd’hui admirer ce tombeau stupéfiant et envisager un parc patrimonial de rang mondial autour des vestiges du marquisat de Haihun. Les archéologues ont ensuite mené une fouille et une conservation scientifiques, permettant à ces objets de restituer, après deux millénaires, un tableau fidèle de l’histoire et de la culture des Han.
Publié le: 9 sept. 2025 · Modifié le: 10 sept. 2025