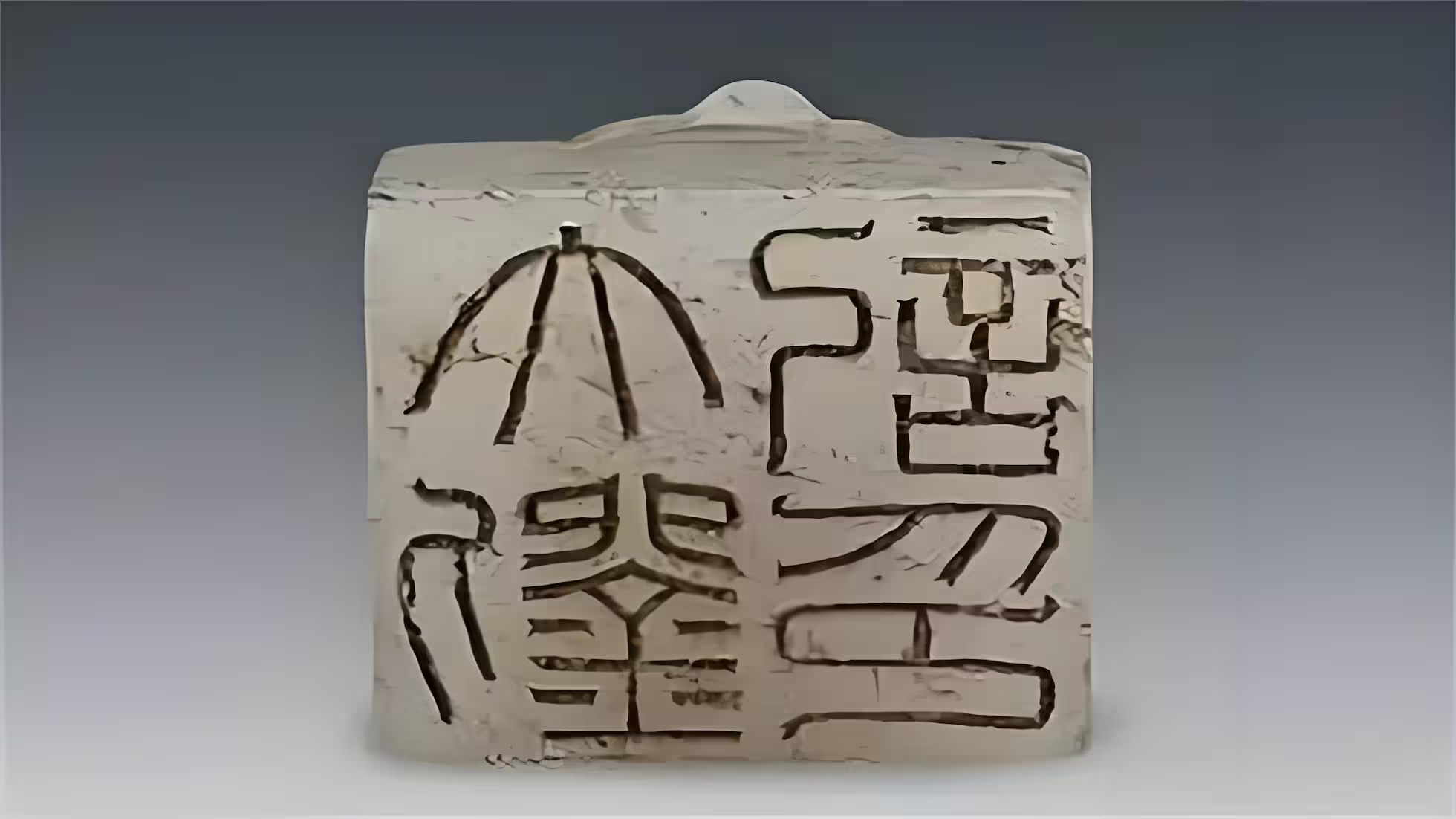Comment suis‑je devenu le ‘dieu des médicaments’ ?

Porté par la politique nationale de zéro droit de douane sur les anticancéreux importés et par l’affaire très commentée de Lu Yong — qui « a offert à davantage de patients une voie d’auto‑secours et a contribué à les tirer peu à peu du gouffre » —, le film « Dying to Survive » est devenu un phénomène.
Cheng Yong, quadragénaire dont le père est paralysé et le mariage brisé, n’a pas les moyens de payer les soins de son père ni la pension de son fils. En revendant le générique indien « Glinib », il aide de nombreux patients atteints de leucémie myéloïde chronique, tout en améliorant sa propre situation. Il sait pourtant que s’occuper d’un médicament interdit et le revendre relèvent de la contrebande et de la vente de faux médicaments — au risque d’une lourde peine de prison. Sous la pression du laboratoire d’origine « Nova » (avatar de Novartis ; « Glinib » renvoie à Glivec/Imatinib), de la police et du trafiquant de faux médicaments Zhang Changlin, il est contraint d’arrêter. Les bénéficiaires — Lü Shouyi, Peng Hao le jeune rebelle venu de la campagne, Liu Sihui dont la fille est leucémique, et le pasteur Liu — doivent s’éloigner de lui. Un an plus tard, incapable d’acheter ni les génériques de Zhang ni l’original de Nova, Lü Shouyi, écrasé par la pression, se suicide. Le destin ramène alors Cheng — devenu entre‑temps un petit entrepreneur — vers le marché gris du « Glinib » indien. L’industriel original intensifiant la répression, la police arrête Cheng et ses proches. Face à cinq ans de prison, Cheng accepte calmement le jugement de la loi. Il estime avoir la conscience tranquille.
Naître, vieillir, tomber malade et mourir — tel est le cycle naturel. Personne ne veut être vaincu par la maladie. Chacun a le droit de vivre — et de se battre pour vivre. « Je veux vivre », dit un vieux patient leucémique au policier Cao Bin. Trois mots qui résonnent dans tous les cœurs : le monde est si beau, qui ne veut pas vivre ? Les scènes les plus fréquentes du film sont des repas : Lü Shouyi et Peng Hao dévorant des plateaux‑repas, Cheng mangeant seul sur le pouce, le père de Cheng avalant sa nourriture de patient, Cheng à table avec la famille de Lü, l’« équipe du médicament » autour d’un hot‑pot. Manger est la base de la survie ; le médicament en est la clé. On ne peut pas cesser de manger, ni interrompre le traitement.
Les vagues de la réalité portent les petits gens au faîte puis les rejettent au fond. Une simple pilule peut saisir une vie à la gorge. En déplorant la fragilité de l’existence, réfléchissons à la responsabilité de l’entreprise. Certes, l’entrepreneur ne survit qu’au prix d’une rude concurrence. Pour un laboratoire d’origine, la chaîne R&D‑clinique‑essais implique d’énormes risques ; sans profit raisonnable, pas de développement vertueux ni de capacité à résoudre des problèmes sociaux plus vastes. Mais la responsabilité sociale ne dépend pas mécaniquement de la taille ou de la puissance. Patron d’un petit atelier, Cheng parvient pourtant à reverser l’essentiel de ses gains pour aider des malades. Un géant pharmaceutique comme Novartis doit‑il vraiment vendre 30 000 yuans le flacon pour tourner ? Difficile de ne pas penser à Tu Youyou et à l’artémisinine : au‑delà du contexte historique, c’est surtout le sens du bien commun qui a conduit les scientifiques à publier la structure et la synthèse, et à aider gratuitement le Vietnam et l’Asie du Sud‑Est. Merck a, lui aussi, distribué l’ivermectine gratuitement dans les régions d’Afrique frappées par l’onchocercose. Une entreprise ne sert pas qu’à gagner de l’argent : elle a une responsabilité sociale.
Ce n’est pas qu’un soupir. La société est imparfaite. L’effort individuel desserre l’emprise du destin ; l’effort collectif, lui, peut éliminer pauvreté et maladie.
Publié le: 8 juil. 2024 · Modifié le: 11 sept. 2025